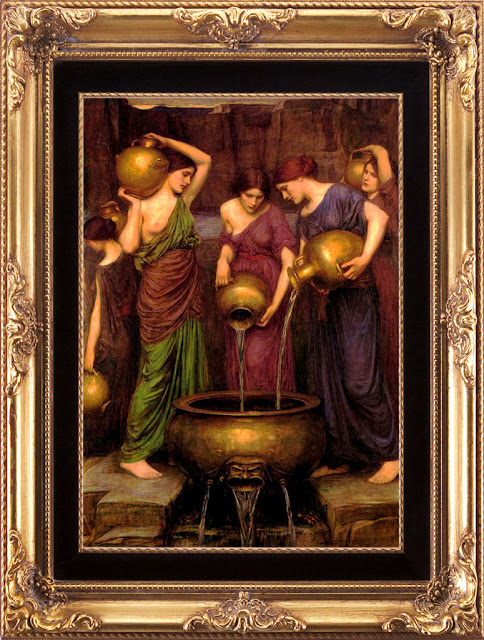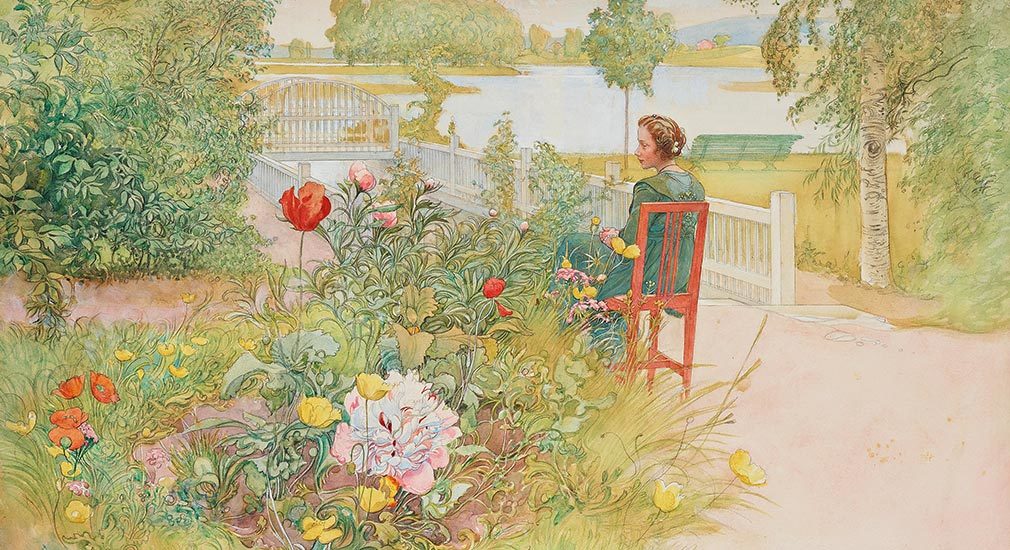Après "avoir le cul bordé de nouilles", je me suis interrogée sur l'origine de la non moins pittoresque expression "se prendre un râteau". Là encore, les explications sont variées. D'après l'Académie Française : "L’expression se prendre un râteau s’emploie lorsqu’une personne qui s’est lancée dans une entreprise de séduction échoue lamentablement et se voit repoussée. (...) On explique en général cette expression par le fait que la douleur de l’échec rappelle celle que l’on ressentirait si, en marchant sur les dents d’un râteau abandonné sur le sol, on recevait le manche de cet outil au visage. Comme ce manche peut frapper violemment les dents, on dit parfois aussi : se manger un râteau. Cependant cette explication, si séduisante soit-elle, n’est sans doute pas la bonne. Il s’agit probablement de la reformulation d’une expression plus ancienne (comme Jeter sa langue aux chiens a été remplacée et adoucie en Donner sa langue au chat). En effet, on lisait à l’article rat de la première édition du Dictionnaire de l’Académie française : « On dit figurément qu’Une arme à feu a pris un rat, quand l’amorce n’a point pris, ou que l’arme ne tire pas. Et on dit d’un homme qui a manqué son dessein, qui a manqué son coup, qu’Il a pris un rat. » Au sujet de cet emploi, la deuxième édition ajoutait : « Il est familier et ironique. » Cette expression (...) est à l’origine du verbe « rater », qui apparaît, lui, avec une définition presque identique à celle de prendre un rat : « Verbe qui se dit d’une arme à feu qui manque à tirer. » Mais d’où vient que le rat était considéré comme un symbole d’échec ? Probablement des farces innocentes de jeunes polissons : « Parmi le peuple on dit, Donner des rats, pour dire, Marquer les habits des passants avec de la craie ou de la farine dont on a frotté un petit morceau d’étoffe attaché au bout d’un bâton et ordinairement coupé en forme de rat. » Littré ajoute : « Il a eu un rat, on lui a posé sur le dos la figure d’un rat pour se moquer ensuite de lui, sorte de plaisanterie qui se faisait les jours gras. » Ainsi, (...) nos rats furent changés en poissons et leur période d’activité se réduisit des jours gras au 1er avril. Avec prendre un rat, on serait passé du sens d’ « être victime d’une innocente plaisanterie » à celui d’« être berné » et enfin d’« échouer ». On aurait pris un rat avant de prendre un râteau. Littré semble confirmer cette hypothèse quand il nous informe que rater signifie « dans le langage libre, ne pas venir à bout d’une femme ».
D'après d'autres sources moins littéraires : "A l’époque du cinéma muet, un gag était récurrent : celui du jardinier qui, ne prêtant pas attention à ses pieds, marche sur les dents du râteau et se fait frapper en retour par le manche de l’outil. Cet épisode, ridicule et douloureux, représenterait le sentiment éprouvé devant cet échec de la séduction. La seconde explication serait l'opposition du râteau à la pelle, à la fois outil de jardinage et synonyme de baiser amoureux." (Magazine "Ca m'intéresse") Ah oui, tiens, tant qu'on y est, d'où vient l'expression "rouler une pelle" ?... Cette fois, c'est Europe 1 qui m'a donné la réponse, et j'ai bien ri en lisant comment nos voisins étrangers évoquent le fameux "french kiss" ! Si vous voulez tout savoir, l'explication est ici, clic ! |