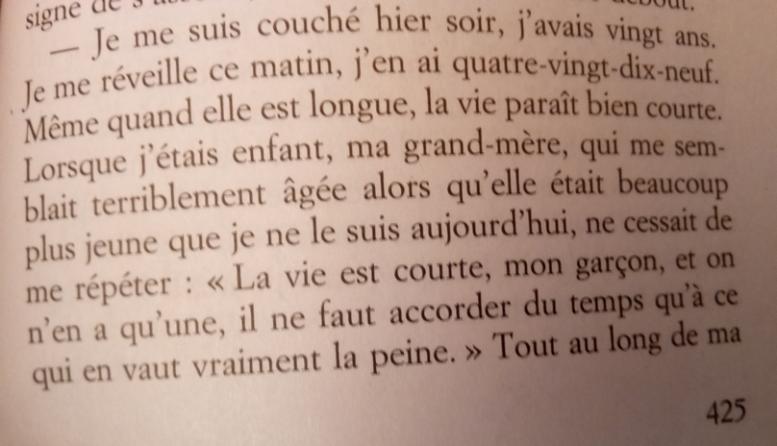"Le saviez-vous ?" - Avoir le cul bordé de nouilles

Source image : Buzzfeed
Je m'interrogeais, ces jours derniers, sur l'origine de cette savoureuse et surprenante expression française qui signifie "avoir beaucoup de chance". Mon cerveau de 4 ans (ou moins) crépite des questions inessentielles et farfelues de ce style. Rien ne les stimule plus que les conversations "sérieuses" : plus je m'efforce de tenir mon rôle et ma place "d'adulte", plus l'enfant, en moi, quitte la pièce et se plonge dans des rêveries abracadabrantes. Heureusement que je ne suis pas sur écoute télépathique : l'espion, au bout du fil, mourrait très certainement de rire.
Donc, pendant que je m'acquittais, en ce début d'année, de joyeusetés adultes telles que paperasserie administrative, rendez-vous au contrôle technique, comptabilité de l'année passée etc, l'enfant en moi se (me) questionnait sur le lien entre les nouilles et le cul, les nouilles et la chance, le confort du cul sur les nouilles, et est-ce qu'elles devaient être cuites ou crues, chaudes ou froides, tomate ou pesto, gruyère ou parmesan, tant et si bien que j'ai fini par faire des recherches et préparer un "Le saviez-vous ?" sur le sujet.
A noter que l'expression a des équivalents tout aussi fleuris dans d'autres langues :
L'association de l'arrière-train et de la chance est ancienne. Selon la linguiste Catherine Rouayrenc, dans Les Gros Mots, l’expression métaphorique originelle serait «avoir le cul verni» (toujours en usage sous la forme « être verni » par exemple), c’est-à-dire « être chanceux », le vernis laissant glisser la malchance sans qu'elle nous touche.
L'ajout des nouilles au cul serait apparu en France vers 1950. Les explications en sont très diverses, par ex. : * Les nouilles sont bon marché et faciles à préparer (qui en a beaucoup a donc la vie facile). * Selon une ancienne superstition française, avoir des nouilles accrochées à soi porterait chance. * Les Marseillais, voisins de l'Italie, auraient ajouté les pâtes à l'expression pour exagérer son sens. * L'ajout proviendrait d'un pari entre le fabricant des pâtes Lustucru et un autre fabricant grenoblois.
Puisque je n'ai pas pu trouver d'origine certaine à l'expression, je vous souhaiterai d'avoir le cul verni ET bordé de nouilles afin de parer à toute éventualité. Je vous laisse choisir ci-dessous le type de nouilles que vous destinez à votre heureux postérieur. Pour ma part, j'opte pour les "Farfalle", parce que j'aime la symétrie régulière de leur forme dentelée et l'insecte dont elle portent le nom (le papillon). Et vous ?
Sources : |

Voir d'autres "Le saviez-vous ?" de La Lutinière