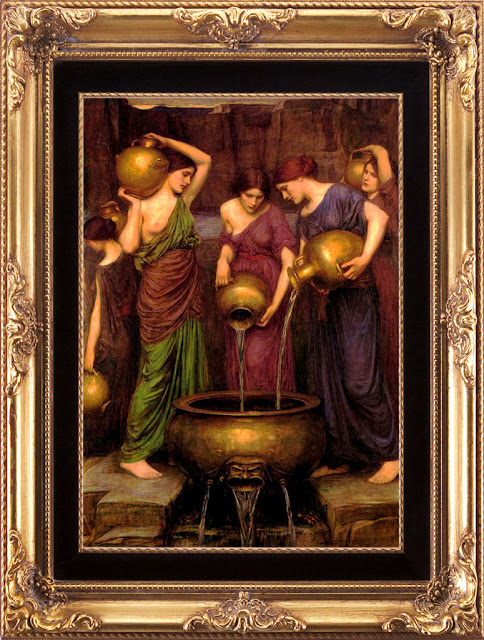Le travail d'une vie
"Qu'est-ce donc que l'alchimie ? A quoi ça sert ? Est-ce sérieux ? Ou simplement une croyance ancienne entourée de mystère et de fantasmes ? Pourquoi parle-t-on d'une technique magique pour transformer le plomb en or ? Physicien de formation, Patrick Burensteinas se présente comme alchimiste. Et il prévient tout de suite : « Si vous venez à cette conférence pour apprendre à faire de l’or, vous allez être déçu ! ». Car la quête de l’alchimiste, ce n’est pas la matière, mais la lumière. Patrick Burensteinas nous invite à découvrir les secrets de cette science bien particulière, loin des idées reçues et des fantasmes (...). En effet, l’or de l’alchimiste, c’est la lumière. Et le but de l’alchimie est de transformer la matière en lumière, en énergie, ce qui est l’inverse du mouvement de la création, qui, elle, densifie la lumière et la transforme en matière.
L’action de la conscience est au cœur de la pratique alchimiste de Patrick Burensteinas. "Comment la science peut-elle être sans conscience, s’interroge-t-il, lorsque l'on sait combien la conscience de la personne qui fait une expérience affecte le résultat de l'expérience ?"
Un alchimiste travaille, parfois sa vie durant, précisément à calmer, à apaiser, à rendre immobile cette conscience constamment agitée. Dans quel but ? Celui de voir au-delà des apparences. Et dans celui, peut-être, de voir apparaître un jour dans son creuset, cette fameuse Pierre philosophale.
Extrait du site Les secrets de l'Alchimie - INREES Evénements (Spiritualités)
|
|